Alerte Varroase !
(cliquez ici pour atteindre la page des comptages 2022)
Nos dernières investigations nous amènent aux affirmations et hypothèses suivantes . Chaque point fera l’objet d’un développement détaillé. L’ensemble des données recueillies cette année feront l’objet d’une publication globale.
– Les produits acaricides n’ont pas d’effet contre les varroas présents dans le couvain
– Il y a corrélation entre l’infestation Varroa et la surface de couvain dans les ruches
– Le cycle naturel d’une belle colonie d’abeilles alimente l’infestation varroa principalement par l’élevage de ses mâles
– Les varroas migrent facilement d’une colonie à l’autre au sein d’un même rucher
– Le remérage naturel est un mécanisme efficace pour faire chuter le nombre de varroas au sein d’une colonie
– Les chutes de varroas dans une ruche infestée et traitée dépassent régulièrement 100 varroas pas jour en saison, jusqu’à 400 varroas observés en une seule journée
– Une colonie équipée d’un traitement acaricide permanent et totalisant une mortalité supérieure à 10000 varroas en une seule saison perd sa vitalité, produit peu de miel, mais exprime une forte résilience malgré une probable charge virale exponentielle. Une multitude d’effets secondaires sont probables entrainant finalment son déclin.
– En fin de saison, la saturation de varroas dans le couvain d’ouvrières explique les maladies et les surmortalités observées
– Le réchauffement climatique et la prolificité des reines alimentent la problématique
– Sans paramètres climatiques favorisant l’action des traitements, Varroa est – hors de maîtrise
– Les évènement biologiques et climatiques naturels ont une action antivarroa insuffisante mais toutefois équivalente à celle des produits acaricides
– Le contrôle et la maîtrise de varroa ne peut être obtenu que par l’action conjointe de la lutte chimique (biologique ou conventionnelle) associée à des paramètres naturels défavorables au développement de l’acarien.
– Le retrait du couvain de mâles est une action efficace pour stabiliser l’infestation
Mis à jour le 19 octobre 2022
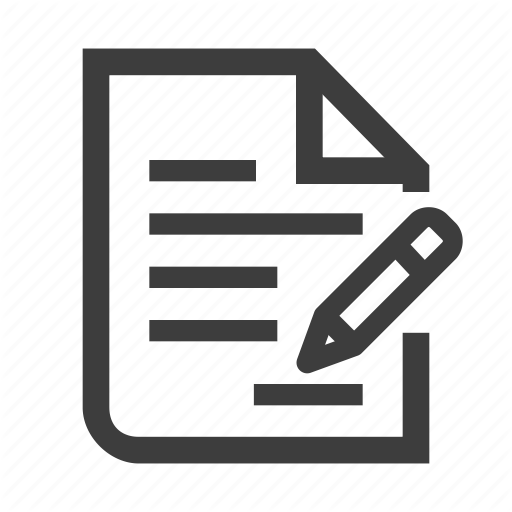
Bulletin d’adhésion
Vous pouvez régler directement l’adhésion au GDSA65 pour l’année 2022

Médicament
Vous pouvez acheter L’APIVAR …
La chaîne du GDSA 65
[yotuwp type=”playlist” id=”UU2xM66HjlzpgxSAfzUedQyw” ]
